Ce petit bout de femme nous fait part dans ce livre titré La Planète Disneylandisée de son expérience d’un voyage autour du monde avec enfants et bagages. Comment le tourisme modifie les modes de vie, façonne les paysages et un regard sur l’évolution des voyageurs. Certains, aujourd’hui, accusent les touristes d’être des pollueurs mais nous sommes tous un jour ou l’autre des touristes dés lors que nous nous distrayons
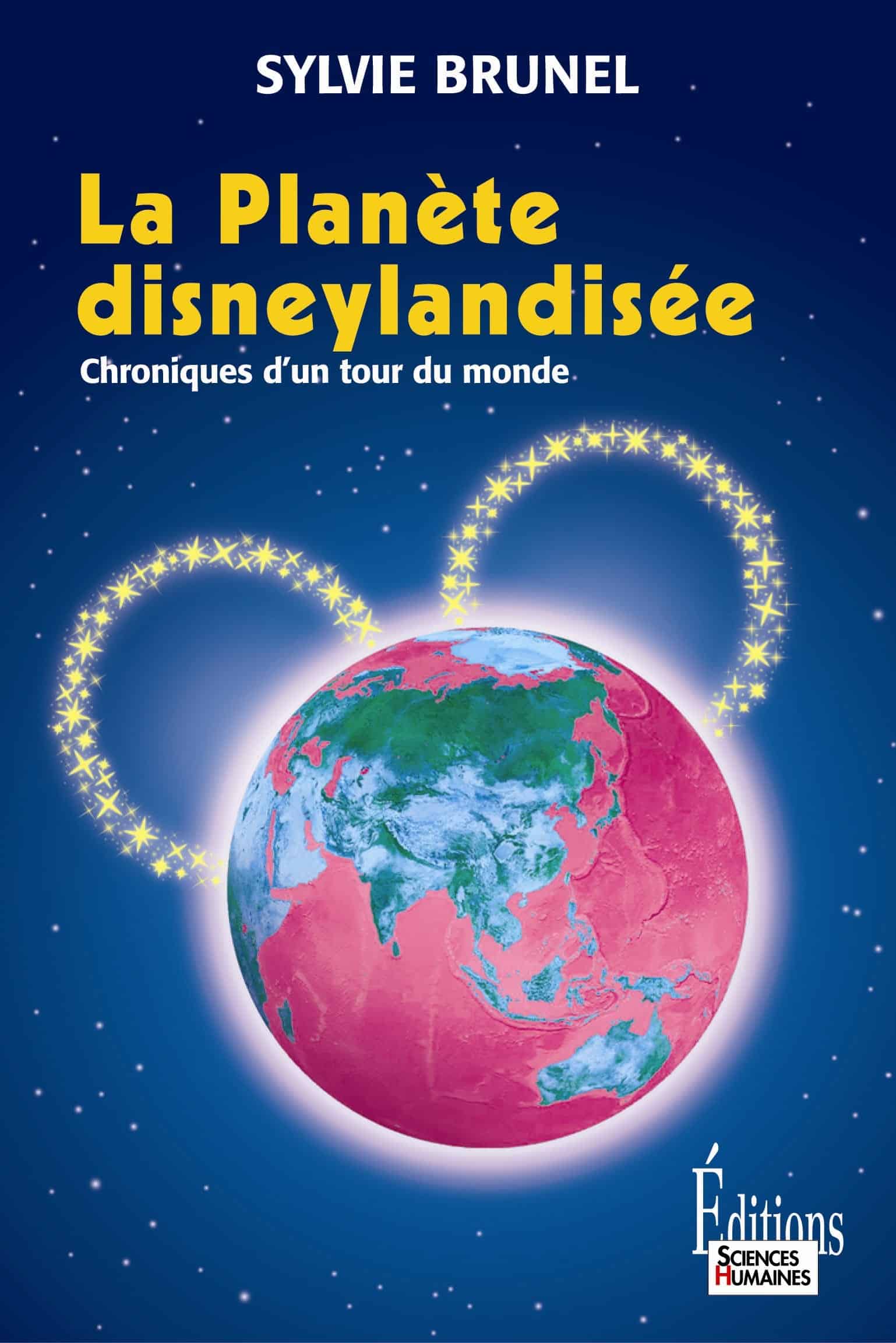 Le développement touristique dans de nombreux pays permet de sauvegarder les populations et de maintenir des familles dans leur région et leur pays sans devoir s’exiler. L’important c’est de faire attention à ce que les revenus de l’industrie touristique bénéficient à ces mêmes populations. Ne pas faire d’autres Varadero à Cuba ou des îles à touristes comme aux Maldives qui ne sont accessibles qu’aux étrangers et n’aident en rien les autochtones.
Le développement touristique dans de nombreux pays permet de sauvegarder les populations et de maintenir des familles dans leur région et leur pays sans devoir s’exiler. L’important c’est de faire attention à ce que les revenus de l’industrie touristique bénéficient à ces mêmes populations. Ne pas faire d’autres Varadero à Cuba ou des îles à touristes comme aux Maldives qui ne sont accessibles qu’aux étrangers et n’aident en rien les autochtones.
Sylvie Brunel, engagée dans l’humanitaire, remet en cause également le tourisme du même nom prétendant que sous couvert de rendre service aux populations, on leur prend en réalité leur travail. 15 jours pour aller aider à remettre en état un village indigène mais sans se rendre compte que les personnes sur place peuvent réparer et faire eux-même le travail pour lequel le touriste « humanitaire » paye.
L’auteur nous décrypte toutes les formes de tourisme et met en garde sur certaines dérives. À lire sans délai.
Le tourisme est une mondialisation pacifiste qui apporte des revenus considérables à la fois aux pays développés comme aux pays en voie de développement. Tout le monde y trouve son compte. Soyons fiers d’être touriste !
INTERVIEW LE POINT – Propos recueillis par Claire Meynial
Le Point : tourisme solidaire, responsable, écotourisme… est-ce bien ce que les gens cherchent ? Dans La Planète Disneylandisée, ils vont tous voir les mêmes choses : Ayers Rock en Australie, chutes d’Iguaçu, baie de Rio…
Sylvie Brunel : Le touriste cherche trois choses : du vert, du zen, de l’authenticité. Cette trilogie laisse de la place à un tourisme qui se veut différent. La grande force des tour-opérateurs, évidemment, est de donner à chacun l’impression qu’il est un touriste différent. Par ailleurs, il y a une démocratisation bienvenue du voyage. Aujourd’hui, le plus gros pourcentage d’augmentation vient de la Chine, d’Amérique latine, ce sont les classes moyennes des pays émergents. Il y a là un gisement fabuleux pour le tourisme de demain.
Peut-on dire qu’il y a aujourd’hui un bon et un mauvais tourisme ?
Ce qui est certain, c’est que le tourisme doit devenir durable. Pour cela, il doit se préoccuper de la pérennité de la démarche touristique. Cela veut dire préserver l’environnement, garantir la qualité de l’expérience du touriste et assurer aux populations locales une répartition équitable de la manne. On se heurte là aux questions inhérentes à tout projet touristique : à qui appartient le foncier ? Les locaux sont-ils dépossédés de l’activité ? Comment se répartit la somme dépensée par le touriste ? Cette somme peut être payée à un tour-opérateur, s’il est responsable, s’il paie correctement ses chameliers, ses guides, son restaurateur… Des lieux revivent ainsi grâce à l’intérêt que leur portent les touristes. L’exemple type, c’est celui des Aborigènes en Australie, qui ont retrouvé une dignité (jusqu’en 1967, ils n’étaient pas citoyens australiens, alors qu’ils étaient là depuis plus de 30.000 ans !). Ou les Dogons, au Mali, qui quittaient leurs falaises, milieu difficile, et sont revenus parce qu’elles attiraient les touristes. A contrario les Masaï, qui ont accepté de se disneylandiser, sont pris au piège d’un tourisme qui prône une Afrique sans Africains, un tourisme d’animaux, sans population. Des espaces prétendument vierges. C’est une dérive dangereuse.
Vous parlez en effet dans « À qui profite le développement durable ? » de cette dérive « animalitaire », qui donne plus de place à l’animal qu’à l’homme. Quel est le risque ?
Dans certains pays africains (Zambie, Botswana, Tanzanie, Kenya…), un quart à un tiers de l’espace est transformé en réserves animalières. C’est d’abord une erreur d’analyse. Souvent, les paysages sont accessibles aux touristes parce que les populations les gèrent. Ce sont les troupeaux de Masaï, qui dégagent les pâturages ! L’idée d’une nature indépendante de l’homme est fausse. La conséquence est extrêmement choquante, on en revient à la réserve à barbelés, les populations sont renvoyées des espaces naturels. Privées d’accès aux territoires coutumiers, elles se clochardisent et vivent en surpeuplement relatif. Par ailleurs, tout espace naturel livré à lui-même s’autodétruit parce qu’il est colonisé par des espèces invasives, comme l’éléphant au Botswana qui détruit les parcs. Il faut une gestion régulée de la faune et la meilleure, c’est celle des populations locales. C’est la gestion intégrée des ressources naturelles. Les communautés ont intérêt à préserver leurs buffles ou leurs lions, parce qu’ils leur rapportent plus vivants que morts. La démarche touristique fait des locaux des gestionnaires avisés de leur patrimoine naturel, alors que, jusque-là, ils avaient intérêt à braconner. L’écotourisme doit associer les communautés, support des paysages.
Qu’est-ce que cette fameuse disneylandisation, contre laquelle vous mettez en garde ?
La disneylandisation, c’est l’exotisation des moeurs, des coutumes et des vêtements locaux, pour en faire des digests aisément appropriables par l’industrie du tourisme. Elle est ambiguë parce qu’elle permet aussi à des cultures mourantes de retrouver une vitalité, une nouvelle identité et d’en rendre les possesseurs fiers, alors qu’ils n’avaient pas conscience de la valeur de ce qu’ils portaient. Les exemples sont nombreux : Maoris de Nouvelle-Zélande, Dogons… ces peuples se réapproprient ainsi leur histoire. Cette démarche, d’ailleurs, se conclut souvent par l’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco.
L’équilibre entre fierté et folklore est difficile à trouver…
La question est de savoir si les populations locales se mêlent du processus touristique ou si elles en sont dépossédées et deviennent des sauvages à plumes. Ont-elles les capacités de maîtriser l’écotourisme mis en place ou deviennent-elles des figurants ? Les Masaï sont en train de devenir des figurants, tout comme les Bushmen ou San, à qui on interdit de rester dans certaines réserves du Botswana.
Faut-il encadrer les touristes qui vont à la rencontre de ces cultures ? Dans La Planète Disneylandisée,certains escaladent les falaises à Ayers Rock, en Australie, sans aucun respect pour leur caractère sacré.
Souvent, le touriste prend le temps de lire des guides, de s’intéresser à une culture, ce qu’il ne fait pas forcément chez lui. Parce qu’il est dans une logique de divertissement et d’appropriation. Cela dit, il y a toujours des dérives et c’est le rôle des tour-opérateurs responsables que d’enseigner le respect. On oppose souvent à tort le routard qui aurait tout compris au touriste ignorant, en voyage organisé. Le routard prétend parfois tout savoir, se croit tout permis, s’immerge dans les populations, déplore la modernité… Alors que le voyagiste responsable, qui veut assurer la pérennité de sa démarche touristique, passe des accords avec la population locale.
Mais que dire du tourisme complètement encadré, tout-compris ?
Il y a en effet un problème avec le tourisme d’enclave, comme celui des îles tropicales. Aux Maldives, il y a les îles à touristes et les autres. Varadero, à Cuba, n’est pas accessible aux Cubains. Dans ce cas, les populations locales sont souvent réduites à des fonctions subalternes. Le touriste a difficilement accès à l’extérieur, on lui dit qu’il compromet sa sécurité en sortant… C’est un tourisme décontextualisé où les populations sont instrumentalisées, souvent par leurs élites.
C’est pourtant souvent la seule forme de tourisme accessible aux petits budgets.
La mise en tourisme obéit à un processus. D’abord, l’avant-garde touristique, en général une élite, prétend découvrir des lieux, en valorisant le fait que les populations locales vivent dans leur isolat. C’est une valorisation de la pauvreté. Quand ce lieu commence à être un peu plus connu, il y a une mise en tourisme. Ce qui se traduit par des équipements. Les locaux les prennent en charge, mais dès qu’il y a un phénomène de masse, ils en sont dépossédés, les chaînes internationales prennent le relais. Vient ensuite un moment de saturation, qui correspond à la congestion des transports, à la saturation de déchets, à des problèmes d’accès à l’eau potable et de dégradation du lieu. Trop couru, il devient un produit international standardisé (Tunisie, République dominicaine). Soit, comme Acapulco, il redevient un lieu de tourisme local. Soit, une prise de conscience conduit à une évolution vers le haut de gamme. L’amélioration progressive est une condition de survie, vers un tourisme de masse respectueux. Le défi à venir, c’est de concilier mondialisation et éco-responsabilité.
Quelle est la part du marketing dans ce tourisme responsable ?
Il ne faut pas que l’écotourisme, ce soit moins de prestations pour plus cher. Souvent, dans un éco-lodge, elles sont réduites au minimum. « Green is gold », l’escroquerie écologique existe. Elle consiste à badigeonner de vert des pratiques d’économie budgétaire. Mais il y a aussi de vrais hôtels écologiques qui essaient de penser l’aménagement de la façon la plus intelligente possible, pour que le touriste soit associé à un véritable projet de mise en valeur d’un lieu. C’est au secteur du tourisme de faire sa démarche de moralisation.
Restera-t-il de la place pour les pays qui ne peuvent pas offrir un tourisme vert ? Ne va-t-on pas créer un tourisme à deux vitesses, entre le Costa Rica et la Croatie, par exemple ?
Des formes de tourisme différentes coexistent. Urbain, mémoriel (Mémorial de Caen, Auschwitz, Rwanda), vert comme au Costa Rica, historique… Tout le monde ne peut pas aller au Costa Rica (qui a complètement refait sa forêt d’ailleurs, elle n’est pas du tout naturelle !) et à chaque période de la vie, du moral, de la situation familiale, des revenus, correspond un type de tourisme. Quand vous êtes déprimé, que vous voulez vous reposer, pourquoi bannir les cocotiers ? La force du tourisme, c’est d’offrir un menu diversifié.
Justement, faut-il s’inquiéter que l’on recrée des forêts, que ce soit au Costa Rica ou à Green Island, en Australie ?
Au contraire, il faut abandonner l’idée d’une nature naturelle. La nature est une construction sociale, qui correspond à l’image que vous vous en faites, au moment où vous vivez. Le bonsaï du Japonais n’est pas le jardin anglais, ni le jardin à la française. Les plus beaux parcs naturels ont été créés ! On a décidé de favoriser certaines espèces, d’en supprimer d’autres, pour évoluer vers un paysage qui correspondait à l’idée qu’on se faisait de la nature sauvage, la fameuse wilderness à l’anglo-saxonne. Depuis que l’homme est sur la Terre, il a totalement anthropisé, façonné les paysages, sauf en dehors de l’oekoumène, dans les très hautes montagnes, la banquise, les déserts absolus. Les plus beaux paysages, les rizières en terrasses balinaises, les falaises dogons, la vallée du Douro avec ses vignes en escaliers… sont le fruit d’un travail humain acharné.
Donc, il ne faut pas avoir mauvaise conscience de voyager ? Le touriste n’est pas uniquement ce méchant pollueur, producteur de CO2 ?
Mais la vie produit du CO2 ! Il ne faut pas avoir mauvaise conscience, mais ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas être vigilant. Le touriste apporte des revenus qui permettent de protéger des espaces qui sinon, seraient dégradés. Sans pouvoir d’achat, il n’y a pas de service, pas d’infrastructure, pas d’argent pour préserver les paysages.
Vous expliquez aussi dans La Planète que mieux vaut un bon touriste qu’un mauvais humanitaire.
Il y a des organisations touristiques qui se veulent à vocation humanitaire, il existe un tourisme de l’humanitaire. Pendant 15 jours, on va se rendre utile aux populations. C’est un leurre, celui qui en bénéficie, c’est plus celui qui part (et le tour-opérateur) que celui qui reçoit l’aide. Cela correspond pour beaucoup de jeunes à une volonté de dépaysement et d’exotisme. Ils pensent se rendre utiles, mais remplissent une envie personnelle. Quand vous êtes dans une ONG, vous avez des candidats pour des missions d’un mois, si possible au bord de la mer et en couple ! Ils ne comprennent pas qu’en faisant un job non qualifié, ils prennent un salaire local. Il ne faut surtout pas penser que tout geste est bénéfique à partir du moment où il se labellise humanitaire. Tout le monde a besoin d’un revenu et d’une dignité.
Donc il vaut mieux un bon chèque de touriste qu’un humanitaire qui va transporter un sac de plâtre ?
Ça ne sert à rien d’aller porter des brancards au Sri Lanka, en effet, il y a des gens pour le faire là-bas et la seule chose que vous faites, c’est voler le revenu de quelqu’un d’autre. Si vous n’avez pas une vraie valeur ajoutée, ne faites pas de l’humanitaire, faites du tourisme. On a des tas de compétences locales et le grand drame de tous les pays dans lesquels on voyage, c’est le chômage. Il ne faut pas distribuer ou, comme disait Jean-Jacques Gabas, « introduire le mythe de la gratuité du capital dans un univers de rareté ». Il faut laisser les boulots aux locaux et les mettre en situation de nous faire aimer et découvrir leurs pays.
Alors, vous a-t-elle convaincu de lire son livre La Planète Disneylandisée ?
Découvrez d’autres articles de blog
Pourquoi voyager avec nous ?

Une réputation sans faille depuis 2008

Un seul interlocuteur en français

Notre présence toute l’année sur le terrain

Notre expertise pour une offre sur mesure








